|
  Imprimer Imprimer
TP n° 2 : Mesure
de la célérité d'une onde
I. Comment mesurer la célérité
d'une onde progressive dans un ressort.
1. Le dispositif.
· Poser le ressort sur
la paillasse. Le maintenir et l' étirer de telle manière
qu'il mesure environ 2 m.
· Pincer deux ou trois spires de l'une des extrémités
du ressort.
· Lâcher et observer le déplacement de la
perturbation le long du ressort.
Questions :
a. Il y-a-t-il transport de
matière, c'est à dire, les spires du ressort avancent-elles
?
b. S'agit-il d'une onde transversale ou longitudinale ?
2. Détermination expérimentale
de la célérité de l'onde dans le ressort.
Matériel mis à
votre disposition :
- un ressort.
- un chronomètre
- une règle
· Proposer un protocole
expérimental permettant de mesurer la célérité
de cette onde.
· Afin de déterminer la valeur moyenne de la célérité
de l'onde dans le ressort, effectuer plusieurs mesures que vous
présenterez dans un tableau.
· En déduire la valeur du retard du point M2 situé
au milieu du ressort sur le point M1 situé au début
du ressort lors du premier passage de l'onde.
II. Comment mesurer la célérité
d'une onde progressive à la surface de l'eau.
1. Le dispositif.
· Verser 0,5 cm d'eau
dans un cristallisoir.
· Placer une burette au-dessus du cristallisoir de telle
manière à ce que les gouttes qui tombent de la
burette arrivent au centre du cristallisoir.
· Régler le plus précisément possible
le débit de la burette afin qu'une goutte tombe au centre
du cristallisoir quand l'onde générée par
la goutte précédente arrive également au
centre au même moment.
· Observer l'onde à la surface de l'eau.
Questions :
a. S'agit-il d'une onde transversale
ou longitudinale ?
b. Le débit dépend-il de la hauteur d'eau dans
la burette ?
2. Détermination expérimentale
de la célérité de l'onde à la surface
de l'eau.
· Quel est l'intérêt
du dispositif mis en œuvre pour la détermination
de la célérité.
· Proposer un protocole expérimental pour la mesure
de la célérité.
· Effectuer plusieurs mesures que vous présenterez
dans un tableau.
· Donner une valeur moyenne de la célérité
de cette onde à la surface de l'eau.
III. Comment mesurer la célérité d'une
onde ultrasonore (40 kHz) dans l'air ?
En cours, nous avons mesuré
la vitesse d'un signal sonore continu en utilisant le principe
de la mise en phase des deux signaux sinusoïdaux.
Dans l'expérience suivante,
vous utilisez un signal ultrasonore en salves.
1. Le dispositif.
On branche sur un oscillographe
bicourbe, les micros 1 et 2.
Le micro 1 (plus près de l'émetteur) sur la voie
1 et le micro 2 (plus éloigné de l'émetteur)
sur la voie 2.
La distance d entre les deux microphones doit être de l'ordre
de 30 cm.
L'émetteur d'ultrasons
est alimenté par un générateur délivrant
une tension de 15 V.
Il est réglé en mode " salves " "
courtes ".
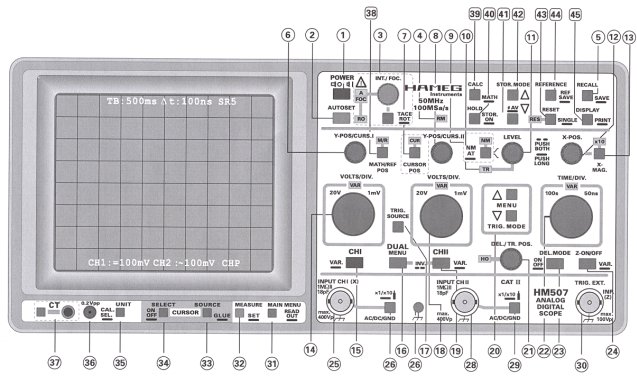
Oscillographe en mode analogique
1 : Marche-Arrêt
14 et 17 : Calibre (V.div-1)
22 : Base de temps
6 : Déplacement vertical du spot 1. Avant toute mesure,
on règle le spot sur 0
8 : Déplacement vertical du spot 2.
12 : Déplacement horizontal des deux spots.
16 : Dual pour visualiser simultanément les voies 1 et
2.
Oscillographe en mode numérique
:
40 : Mémorisation d'un
signal
43 : Mode monocoup
2. Mesures.
Indiquez les réglages
choisis sur l'oscilloscope :
Calibre de la voie 1 :...............
Calibre de la voie 2 :...............
Base de temps :...................
Dessiner l'oscillogramme obtenu.
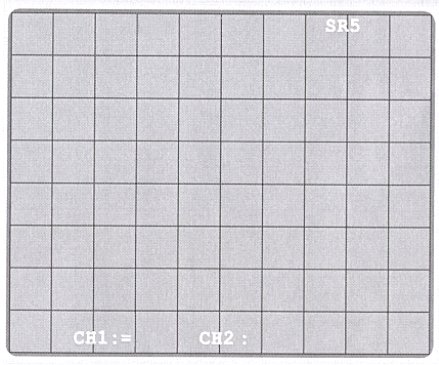
- Déterminer le retard
t en les deux débuts de réception
des salves.
- Mesurer la distance d
séparant les deux microphones.
- En déduire la célérité
v d'une onde ultrasonore dans l'air.
- Comparer cette valeur à
la celle de la célérité d'une onde sonore
dans l'air v = 330 m.s-1.
- En conclure si l'air est un
milieu dispersif ou non ?
  Imprimer Imprimer
TP n° 3 : Le
phénomène de diffraction
Le phénomène
de diffraction est caractéristique des ondes périodiques.
Buts : Mettre en évidence
le phénomène de diffraction des ondes ultrasonores
et lumineuses.
Etudier les conditions dans lesquelles le phénomène
se manifeste (largeur de fente).
I. Diffraction des ondes
ultrasonores 3 dispositifs
Position du problème
:
Le phénomène
de diffraction est-il observable avec des ondes ultrasonores
et dans quelles conditions ?
1. Diagramme de rayonnement
de l'émetteur.
On effectue un montage suivant
:
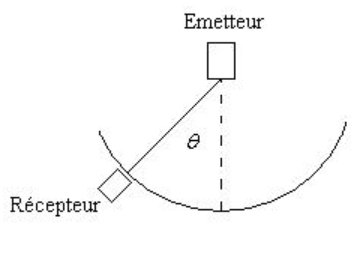
Le récepteur d'ultrasons
R peut se déplacer sur un demi-cercle centré sur
C.
Le récepteur est relié à la voie 1 de l'oscilloscope.
On décale le récepteur de 5° à chaque
fois et on mesure l'amplitude du signal à l'oscilloscope.
On complète le tableau
suivant :
|
0° |
5° |
10° |
15° |
20° |
25° |
30° |
35° |
40° |
45° |
|
Calibre (V/div) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coefficient de balayage(ms / div) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
angle (°) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tension Um (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
On trace à l'aide d'un tableur (excel) la représentation
graphique Um = f(q)
Questions et interprétation
:
· A partir du graphe,
indiquer si toutes les régions de l'espace sont atteintes
par les ondes ultrasonores.
· Définir approximativement la valeur du secteur
angulaire d'émission de cet appareil.
2. Diffraction par une fente rectiligne de largeur 0,8 cm.
On effectue un montage équivalent
à celui-ci :

Largeur de la fente = 2,0 cm
Distance de l'émetteur
à 20,0 cm de la fente environ.
On complète le tableau
suivant :
|
0° |
5° |
10° |
15° |
20° |
25° |
30° |
35° |
40° |
45° |
|
Calibre (V/div) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coefficient de balayage(ms / div) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
angle (°) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tension Um (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
On trace à l'aide d'un
tableur (excel) la représentation graphique Um = f(angle)
Questions et interprétation
:
· Quel est l'intérêt
de la première expérience ?
· Quelle est la période T et la fréquence
f des ondes ultrasonores ?
· Quelle est l'ordre de grandeur de la longueur d'onde l
de ces ondes ?
· Déterminer sur le graphe la valeur minimale amin correspondant au premier minimum d'amplitude.
Cette valeur amin est appelée demi-écart angulaire.
· Vérifier que  (attention : angle en rad)
(attention : angle en rad)
II. Diffraction des ondes
lumineuses : 3 dispositifs
Voir cours
1. Expérience.
Position du problème
:
· Réaliser un
montage permettant de mettre en évidence le phénomène
de diffraction et montrer ainsi que la lumière peut être
décrite comme une onde.
· Vérifier la pertinence de la relation 
- Réaliser le montage
suivant :
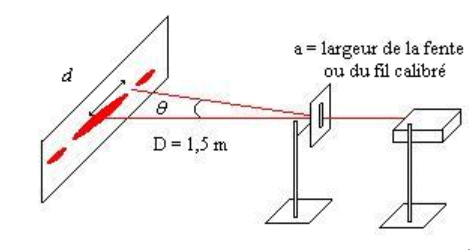
d : distance entre le centre de la frange lumineuse centrale
et la première extinction.
D : distance entre l'écran (mur) et la fente. D
= 1,5 m.
a : largeur de la fente ou du fil calibré.
l : longueur d'onde de la lumière du laser. l
= 650 nm.
- Placer une feuille de papier
millimétré sur le mur et relever la taille de la
frange lumineuse centrale en mesurant la distance 2d entre les
deux premières extinctions.
- Réaliser cette mesure pour différentes largeurs
de fente ou de fil calibré.
- Etablir la relation entre d, D et q.
- Compléter le tableau suivant :
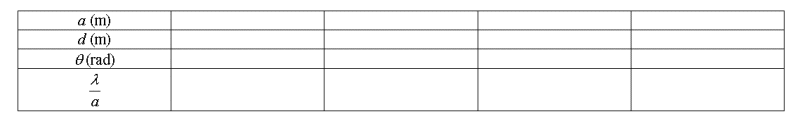
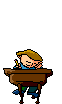
Questions et interprétation
:
· Dans quelle direction
les taches de diffraction s'étalent-t-elles par rapport
à la direction de la fente ?
· la relation  est-elle vérifiée ? est-elle vérifiée ? |